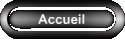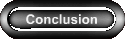|
1-La participation des femmes à l'éffort de guerre dans le domaine du travail. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
En 1914, déjà 7,7 millions de femmes travaillent. La guerre sensibilise le travail des femmes car la pénurie de main-d’œuvre correspond à la nécessité, pour de nombreuses femmes de travailler. A la fin de l’année 1917, le personnel féminin dans l’industrie et dans le commerce dépasse de 20% son niveau d’avant guerre. Pour faire admettre les femmes dans l’industrie de guerre, il a fallu vaincre la méfiance des industriels, multiplier les circulaires, ouvrir des bureaux d’embauche et faire de nombreuses affiches. Début 1918, les femmes forment un quart de la main-d’œuvre dans l’industrie de guerre. Quatre cent trente milles munitionnettes venues de tous les horizons couturières, ménagères, artiste au chômage, jeunes filles sans travail sont attirées par les hauts salaires : véritable transfert de main-d’œuvre, sans lien aucun avec les capacités de chacune. Les ouvrières donnent très vite satisfaction : « Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient la guerre » aurait dit le maréchal Joffre. Les femmes sont minimes dans la fonderie ou l’aéronautique, cependant elles sont très nombreuses dans la fabrication des obus (on les appelle les obusettes), cartouches, grenades et fusées, employées comme manœuvres aux travaux mécanique en série et à la fabrication des pièces fines ou à la vérification. Là où leurs rendements sont les plus élevés.
Les femmes enrôlées dans l'industrie d'armement.
Les industriels affectent les ouvrières à des tâches délimitées et organisent la production en série. On découvre les « qualités féminines » : aptitude aux travaux monotones, patience et habileté… A l’arrière on assiste à une sorte de mobilisation féminine, sans précédent. Dans les administrations, dans les usines, dans les ateliers, partout les femmes remplacent les hommes. Certaines usines se créent de toutes pièces, comme celle d’André Citroën, quai de Javel : modernes, rationalisées, tendant vers la monoproduction d’obus de 75 mm, elles peuvent employer jusqu’à 80 % de femmes dans certains ateliers. Ailleurs, la main-d’œuvre masculine est encore largement nécessaire, comme chez Renault où les ouvrières ne sont que 30 % ou chez Blériot, 10 %. Et il n’y a pas que Paris. Les autres grands centres industriels sont aussi sollicités, à plus forte raison après l’occupation du Nord.
Une femme travaillant sur un atelier. Des années de guerre, l’opinion publique a retenu la forte présence féminine dans les industries mécaniques et dans les bureaux, mais en 1917 leur taux d’activité n’est pas estimé à plus de 60. Leurs accès à des métiers interdits frappe bien sûr les imaginations là, le passage des femmes sera bref, il leur faudra attendre encore un demi-siècle pour y accéder à nouveau. Mais, ailleurs, les femmes gardent leur place, en particulier dans les usines au travail recomposé par l’organisation scientifique du travail et la mécanisation. Dans l’agriculture, avant la guerre les femmes ne s’occupaient pas des récoltes, c’était le travail des hommes. Le 7 août 1914, Viviani, le président du Conseil, fait appelle aux femmes pour qu’elles achèvent la moisson puis qu’elles entreprennent les travaux de l’automne. Elles ont accompli l’essentiel du travail dans un grand élan patriotique et avec un sens nouveau de la solidarité. Le travail repose sur les 3,2 millions d’agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes d’exploitant. Les femmes deviennent maréchal-ferrant, garde champêtre, boulangère comme Madeleine Deniou d’Exoudun qui, pendant des mois, fait avec son frère de 14 ans, 400 kg de pain par jour. Toutes les villageoises travaillent pour le salut de la France. Du fait de la guerre, 850 000 femmes d’exploitants, un bon tiers de celles déclarées au recensement de 1911, se trouvent à la tête de l’exploitation et 300 000 femmes d’ouvriers agricoles ont à charge une famille. Elles ont de lourdes responsabilités auxquelles elles étaient peu préparées (décider des productions, diriger la main d’œuvre, vendre). Chefs d’exploitation ou pas, les paysannes joignent aux tâches qui leur étaient traditionnellement imparties une grande part des travaux d’hommes, même ceux qui exigent de la force ou un long apprentissage. En Dordogne, la femme aurait remplacé l’homme dans la proportion d’1/3, en Charente dans la proportion des 4/5ème, dans les Basses-Pyrénées des 9/10ème. Pour laisser le moins possible de terres en friches, susceptibles d’être réquisitionnées par la commune, les paysannes s’épuisent au travail. La réquisition des animaux de trait, chevaux et bœufs ne facilite pas les choses, et toutes n’ont pas les moyens même en se groupant de se mécaniser. Mais les hommes veillent quand même, ceux des fratries restés sur place et aussi les maris qui écrivent, parfois chaque jour : « Sème comme je te l’ai dit ; écris-moi au fur et à mesure des morceaux que tu a fait » ; ou « C’est bien compris : d’abord les bœufs, puis le carré de luzerne, puis le jardin ; tu en as pour huit jours. Je te renverrai sur ta lettre ce qu’il faut faire l’autre semaine ».
De nouveaux métiers pour les femmes: Une conductrice de Tramway à Toulouse pendant la guerre.
Dans les campagnes comme dans les villes, des métiers exclusivement masculins en temps de paix basculent sous la responsabilité des femmes : aidées souvent par un grand fils ou un jeune frère, elles deviennent bouchères, gardes champêtres, prennent en charge les classes de garçons dans le primaire et le secondaire. Dans les services publics, les usines, les mines, des ouvriers-mobilisés aux compétences techniques spécifiques sont rapatriés du front. Mais pour les métiers peu qualifiés, vite appris, voire interdits dans le cadre des conventions collectives, les femmes sont là. Les crieuses de journaux renouvellent les mœurs de leurs confrères ; « plus de courses échevelées le long des boulevards, plus de cris indistincts et assourdissants où se complaisaient naguère les vendeurs de journaux ; elles circulent comme tout le monde et d’une voix nette et posée offrent leur marchandise ; quelques-unes font même preuve de psychologie et annoncent les bonnes nouvelles ». Pour ce qui est des transports, au début de la guerre le Syndicat des transports parisien s’est opposé à l’embauche d’un personnel féminin. Mais les Parisiens en ont vite assez d’attendre des heures une hypothétique voiture ou d’aller à pied ; habitués aux moteurs, ils n’aiment guère non plus pédaler dans les rues ou appeler un cocher qui ressort son fiacre avec bonheur. Même si au début les syndicats s’y sont opposé, les femmes ont obtenu du préfet de la Seine en août 1914 l’autorisation d’être employées comme receveuses sur voitures, les compagnies de transport demandent et obtiennent en 1915 celle de les utiliser comme wattwomen (conductrice d’un véhicule électrique), à l’image de la province, mais à condition de reprendre leurs employés mobilisés à la fin des hostilités. Durant les quatre années de guerre, les femmes vont assurer la quasi-totalité des tâches réservées jusque là aux hommes. On trouve ainsi des factrices, des chauffeuses de locomotives, des allumeuses de réverbères, des conductrices de tramways. Il y en a même qui deviennent mécaniciennes de locomotives. Certaines ont pris en charge des hôpitaux, des bibliothèques, des services d’entre-aides. N’oublions pas, par ailleurs, la forte présence féminine dans un monde d’hommes, sur le front et à l’arrière auprès des blessés, avec les « anges blancs », ces infirmières qui soigneront trois millions de soldats blessés. On compte sans doute 100.000 femmes soignantes, dont des dizaines de milliers bénévoles de la Croix-Rouge et autres associations, et encore 10.000 sœurs congréganistes
Les femmes sont assignées aux travaux de nettoyage et de manutention, aux travaux en série qui se mécanisent grâce à l’impulsion du ministère de la Guerre : soudure, polissage, conduite des presses et des ponts roulants... Les conditions de travail sont terribles, il n’y a plus de limitation de la journée à 8 heures, d’interdiction du travail de nuit, de repos hebdomadaire : 12 heures par jour, deux jours de repos par mois, puis, en 1917, une circulaire qui demande la journée de 10 heures, l’installation de sièges, la journée du dimanche, si possible. Le turn-over est fort, les rendements parfois mauvais. Pour limiter ces contraintes, les salaires comportent des minima et des primes de productivité.
Exemple de répartition du personnel dans une société de construction mécanique
|
||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Témoignage d'une ouvrière: « L'ouvrière,
toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle
soulève la partie supérieure. L'engin en place, elle
abaisse cette partie, vérifie les dimensions ( c'est le
but de l'opération), relève la cloche, prend l'obus et
le dépose à gauche.
Une chanson populaire:
C'est elle ordonne C'est qui est patronne C'est moi qu'elle fait marcher C'est elle qui commande C'est elle qui marchande Et moi j'ai le droit d'les lacher C'est elle qui pilote C'est elle qui capote C'est moi qui vais su'l'gazon! Quand je n'suis pas en smoking Elle va toute seule au dancing Il paraît que ça n'a rien de shoking
|
||||||||||||||||||||||||
|
|